
Par Philippe Piguet
Arménien d’origine, né à Istanbul, installé en France depuis cinquante-sept ans, Sarkis développe une œuvre hybride, qui en appelle au métissage des pratiques et des cultures, chargée tout à la fois de sa propre histoire et d’une passion pour celle de l’art, toutes disciplines confondues, en quête d’une forme d’humanisme nourri de spiritualité. L’esthétique nomade et altruiste qui la qualifie s’exprime notamment à travers objets et installations fondé sur l’idée d’un perpétuel ressourcement. Figure majeure d’une histoire de l’art vivant, Sarkis a notamment participé à l’exposition « Quand les attitudes deviennent forme », organisée par Harald Szeemann en 1969, à Bern, aux Documenta V de 1977 et VI 1982, ainsi qu’aux « Magiciens de la Terre », rassemblés en 1989 par Jean-Hubert Martin, à Paris. En 2018, il a été invité à la Biennale de Venise à représenter la Turquie qui y participait pour la première fois de son histoire ; il était aussi présent au Pavillon arménien qui a reçu cette année-là le Lion d’Or. Polymorphe, son œuvre est un immense chant d’espoir et de confiance en l’homme dans toute sa diversité et sa complexité. Rencontre.
https://www.artinterview.com/interviews/sarkis/

/image%2F1541165%2F20210521%2Fob_b26485_besson-mylene-2021.jpg)
/image%2F1541165%2F20210521%2Fob_4bc769_2018-la-guerre-dommages-collateraux-5.jpg)


/image%2F1541165%2F20210518%2Fob_7efee2_art-absolument-n-96-avril-mai-ju.jpg)
/image%2F1541165%2F20210518%2Fob_1b0801_art-absolument-n-96-avril-mai-ju.jpg)
/image%2F1541165%2F20210518%2Fob_bb8ac2_art-absolument-n-96-avril-mai-ju.jpg)
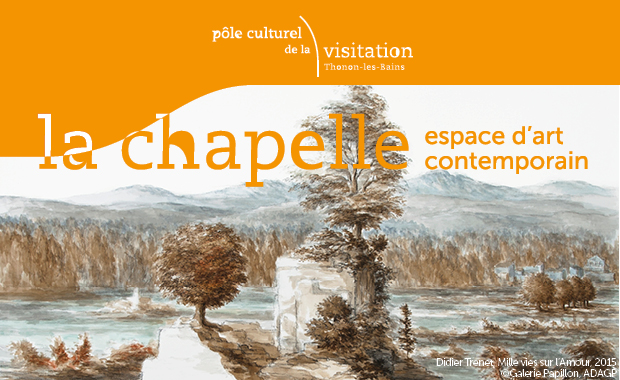


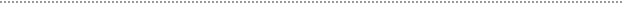
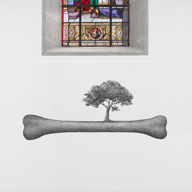






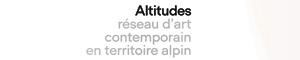

/image%2F1541165%2F20210429%2Fob_fd38ef_merelle-fabien-bouture-encrre-et-a.jpg)

/image%2F1541165%2F20201213%2Fob_e7ed38_art-press-kriki-n-483-484.jpg)
/image%2F1541165%2F20201114%2Fob_cb764d_sans-titre-1.jpg)
/image%2F1541165%2F20201114%2Fob_2e3059_sans-titre-2.jpg)
/image%2F1541165%2F20201026%2Fob_c7eaea_couvent-de-la-touette-art-absolument.jpg)
/image%2F1541165%2F20201026%2Fob_a9fcb1_lelievre-anais-art-absolument-n.jpg)
/image%2F1541165%2F20201011%2Fob_628242_001.JPG)
/image%2F1541165%2F20201011%2Fob_f7524b_002.JPG)
/image%2F1541165%2F20201004%2Fob_18415a_33-lesteven-claire-le-lac-annecy.jpg)
/image%2F1541165%2F20201004%2Fob_cd3e16_sans-titre-1-modifie-25.jpg)